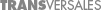L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et la biodiversité
20 avril 2005 | par Suman Sahai
Nous avons assisté dans les dernières décennies à un changement radical de la place des ressources biologiques. Ce qui était une ressource « naturelle », accessible pour tous, s’est maintenant transformé une ressource « économique », en cours de privatisation. Au cours de ce processus, une propriété publique, détenue et enrichie collectivement au sein des communautés, est transformée en une propriété privée, appartenant à quelques uns et détachée de plus en plus des communautés locales.
On retrouve les échos de ce changement dans les décisions nationales et internationales. Deux traités internationaux majeurs, l’Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au Commerce) au sein de l’OMC et la Convention pour la Diversité biologique des NationsUnies, avec deux approches contradictoires, sont en train de dessiner les régimes nationaux des États membres de l’OMC et des NationsUnies, en regard des ressources biologiques et des connaissances indigènes. L’Accord sur les ADPIC engendre la privatisation des ressources biologiques en autorisant le dépôt de brevets sur le matériel biologique et les savoirs indigènes qui leurs sont associés, alors que la CDB reconnait des droits aux communautés indigènes sur leurs ressources biologiques et leurs savoirs.
L’article 27.3(b) de l’Accord sur les ADPIC a placé les ressources biologiques dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, et ce faisant ouvre la voie à la mainmise privée au travers de droits commerciaux exclusifs.
La diversité biologique est devenue le vivier dans lequel l’industrie biotech puise ses matériaux de base. Alors que les entreprises des pays développés maîtrisent les techniques de l’ADN Recombinant, les matières premières biologiques sont localisées principalement dans les zones tropicales et semitropicales d’un Sud en voie de développement. Il en va ainsi non seulement des ressources génétiques ellesmêmes, mais aussi des savoirs qui leurs sont associés, tels qu’ils résident dans les communautés indigènes.
Dans le but d’obtenir l’accès aux ressources biologiques, les industries transnationales du vivant, au travers de leurs gouvernements, ont étendu les droits de propriété intellectuelle jusqu’aux matériaux biologiques euxmêmes, et cela à l’échelle mondiale. Ce changement a eu lieu lors de l’« Uruguay Round », commencé en 1986 au sein du GATT et achevé en 1994 à Marrakech par la création de l’OMC. C’est durant ce cycle de négociations que la vie et les ressources génétiques ont été pris dans les rêts d’un unique système global pour les droits de propriété intellectuelle.
L’Accord sur les ADPIC couvre ainsi, parmi de nombreuses autres choses, le droit d’auteur et ses droits voisins, les marques déposées, tout comme les appelations d’origine accordées par exemple au Champagne ou au Whisky Ecossais, les dessins et modèlés industriels, les brevets et la protection des variétés végétales, le dessin des circuits intégrés des industries électroniques, la protection des informations sensibles, le secret des affaires et la concurrence déloyale.
Les droits de propriété intellectuelle sur les matériaux biologiques
L’élément central de l’Accord sur les ADPIC relatif à l’agriculture et à la sécurité alimentaire est l’obligation faite aux
États membres de l’OMC d’ouvrir le dépôt de brevet à toutes les inventions, qu’elles concernent les produits comme les processus, dans tous les champs de la technologie sans discrimination. La raison principale de ce nouvel intérêt pour les brevets est lié au développement très rapide de la biotechnologie dans l’agriculture.
Il y a quatre options ouvertes aux États membres par l’article 27.3(b) de l’Accord sur les ADPIC :
* la première consiste à accorder des brevets sur tout, ce qui inclut alors tous les matériaux et toutes les formes de technologies ; * la seconde vise à exclure les plantes, les animaux et les processus biologiques, mais pas les variétés végétales. Cela signifie que l’on peut refuser la brevetabilité des plantes sauvages, des animaux et des processus biologiques naturels par lesquels ils sont créés, mais pas celle des semences agricoles ; * la troisième option consiste à exclure les plantes, les animaux et les processus biologiques de la brevetabilité, mais d’introduire un droit sui generis pour la protection des variétés végétales. Un tel droit sui generis permet à chaque pays de créer un système législatif se limitant à la protection minimale définie par l’OMC ; * la dernière option vise à exlure de la brevetabilité les plantes, les animaux et les processus biologiques essentiels mais pas les variétés végétales, et d’accorder aussi un droit sui generis. Cette derière option signifie que les varétés végétales pourront être brevetées ou protégées par un système spécifique créé pour l’occasion.
La majeure partie des pays en développement ont choisi l’option trois. Un droit sui generis permet de s’adapter au problème réel des agriculteurs et permet à chaque pays de produire ses propres règles pour la protection des variétés végétales. Un tel droit sui generis reconnu est celui de l’Union Internationale pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV). Il a été initialement développé en Europe et il est dorénavant adopté par les pays industrialisés. Le système de l’UPOV a connu plusieurs changements depuis sa création en 1961, mais jamais pour offrir des concessions aux fermiers ou aux fabricants de semences fermières.
L’article 27.3(b) est certainement un des plus controversé de l’ensemble du Traité de l’OMC. Il impose aux États membres de définir des règles pour la brevetabilité des microorganismes et des organismes génétiquement modifiés (au titre de « processus microbiologiques et nonbiologiques »), ce que la plupart des pays sont actuellement en train de mettre en place. Il y a une tendance actuelle qui montre que certains États, dont les ÉtatsUnis, aimeraient éliminer l’option d’un droit sui generis alors que la majeure partie des pays en développement sont au contraire en train de rédiger des législations nationales pour l’implémenter. Il y a des propositions pour que l’UPOV soit considéré comme le seul droit sui generis acceptable pour les obtentions végétales. Or l’UPOV ne va pas dans le sens de l’intérêt des pays en développement, car il n’offre aucun droit pour les paysans. Les droit vont à sens unique, et sont accordés à l’obtenteur, ce qui de nos jours signifie de plus en plus « la compagnie ».
Les brevets sur les semences limiteraient drastiquement l’autonomie des paysans qui devraient acheter des semences nouvelles pour chaque récolte. Les femmes seraient particulièrement pénalisées par l’adoption des règles de l’UPOV, qui limiteraient le droit de replanter leurs propres semences.Or ce droit leur permet actuellement de maintenir des cultures vivrières pour nourrir leurs familles.
Il y a aussi des contradictions entre les régimes de brevets définis par l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la Diversité biologique (CDB) et le Traité International sur les Ressources phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO (Food and Agriculture Organisation, agence des NationsUnies). Ces divergences sont largement considérées comme plus politiques que légales, et le gouvernement des ÉtatsUnis a fait de l’application de l’Accord sur les ADPIC une priorité de sa politique étrangère. On devrait donc voir émerger ces conflits au sein de l’Organe de Règlement des Différends de l’OMC dans les années à venir.
Les contraintes définies par l’UPOV 1991 vont diminuer de façon significative la capacité des communautés paysannes à être autosuffisantes en matière de semences et à conserver leur autonomie de choix. Cette réglementation met en avant les intérets des semenciers industriels du Nord plutôt que ceux des communautés paysannes. L’UPOV définit une obtention végétale protégeable comme étant « distincte » des autres variétés, produisant une descendance « uniforme », et restant génétiquement « stable » par delà les générations. Avec l’accord UPOV de 1991, une autre qualité, la « nouveauté » a été ajoutée aux caractéristiques minimales requises. Le critère d’uniformité peut contribuer à l’érosion génétique. De surcroît, maintenir une certification UPOV est en dehors des moyens de la majeure partie des paysansreproducteurs. Bien que les paysans se soient efforcés de cultiver des variétés végétales stables, conservant leurs qualités dans le temps, leurs variétés ne parviennent que rarement à remplir les critères de l’UPOV.
Ces conditions drastiques pour obtenir un certificat d’obtention végétale sous le régime de l’UPOV vont à l’encontre de l’objectif de maintenir et d’élargir la diversité biologique. Plus encore, le type même de protection qu’il offre est un droit exclusif de monopole. Cela contraste fortement avec les but plus larges d’une rémunération collective et d’une répartition équitable des bénéfices qui sont définis dans d’autres accords globaux comme la CDB et le Traité international de la FAO.
L’UPOV est contraire aux intérêts des pays en développement.
De nombreux organismes, dont l’OMC ellemême, tendent à réduire l’option d’un droit sui generis à un seul modèle législatif, tel qu’il est défini par l’UPOV. Pourtant, l’UPOV n’est pas mentionné dans l’Accord sur les ADPIC. De nombreux experts juridiques et économiques indépendants ont souligné que l’UPOV ne pouvait pas être accepté comme un droit sui generis efficace dans le cadre de cet Accord, et qu’il reste aux États un large espace de négociation, de flexibilité et un pouvoir discrétionnaire dans l’interprétation de l’option sui generis. Le régime de l’UPOV met en avant des variétés végétales adaptées pour des systèmes agroindustriels. Dans ces modèles, les paysans doivent payer des redevances pour les semences, et le secteur semencier devient une opportunité pour les entreprises agrochimiques et biotechnologiques. Les plantes sont sélectionnées pour donner leur plein rendement en fonction des intrants chimiques ou du choix des gènes brevetés, au détriment d’une biodiversité durable. L’UPOV décourage automatiquement les semences ayant un large spectre génétique qui les rend pourtant adaptées aux situations locales, tant pour le marché que dans les champs.
L’impact des régimes du type de l’UPOV sera désastreux pour les pays en développement. D’abord, les paysans qui ont contribué aux variétés sur la base desquelles les obtenteurs développent leurs propres activités n’auraient aucun droit, ceuxci étant réservés aux semenciers. Ensuite, les conditions liées à l’UPOV sont basées sur des économies de type industriel, dans lesquelles seulement 2 à 5% de la population vit de l’agriculture, et dans lesquelle existent peu de petits paysans pauvres et marginalisés. L’UPOV avantage particulièrement les pays pour lesquels l’agriculture est avant tout une activité commerciale. Pour la majorité des paysans en Asie, en Afrique et en Amérique latine, c’est une activité vivrière.
Appliquer l’Accord sur les ADPIC aux ressources biologiques est opposé aux intérêts des peuples indigènes, des hommes et des femmes vivant de la terre. Les femmes apportent un soin plus particulier à l’usage des ressources biologiques pour se nourrir, se soigner et d’autres activités quotidiennes, et elles utilisent ces ressources pour améliorer la santé et la nourriture de leurs familles autant que pour obtenir des revenus. L’Accord sur les ADPIC ne reconnaît aucun droit aux communautés locales sur leurs propres ressources et sur les savoirs qui leurs sont associés. Ils ne parviennent pas à reconnaître et protéger les droits des paysans, qui sont pourtant explicitement reconnus par la CDB et l’ITPGR. De plus, l’Accord sur les ADPIC, contrairement à la CDB ou l’ITPGR ne reconnaît aucun apport particulier des femmes dans les communautés rurales pour la conservation de la biodiversité. Il ne dispose d’aucun levier pour assurer le partage des bénéfices des technologies et de l’innovation, ou pour obtenir le consentement éclairé des peuples, et principalement des femmes, dont on collecte le savoir pour l’intégrer dans ces innovations technologiques.
Impact sur la biodiversité, les communautés villageoises et principalement les femmes
La biodiversité est la base de la nourriture et du bienêtre autant que de la sécurité et de la souveraineté alimentaire des hommes et des animaux vivants dans les communautés pauvres et marginalisées. Modifier profondément la dynamique millénaire de contrôle et d’usage de la biodiversité en imposant des règles de propriété intellectuelle va accentuer l’appauvrissement et la marginalisation des communautés locales. Les femmes, en leur sein, seront doublement désavantagées, à la fois en termes économiques et dans leur pouvoir de décision.
Les régimes de propriété intellectuelle sur les ressources biologiques, et leur commercialisation pour les échanges marchands va mettre en danger les ressources ellesmême. L’exemple du fermier canadien Percy Schmeiser et son procès qui l’a opposé à Monsanto autour d’une violation de propriété intellectuelle nous montre comment ce type de régime de propriété est utilisé par les grandes corporations pour imposer leur monopole. Monsanto a porté plainte contre Schmeiser pour les immenses dommages qui lui auraient été causés par une « violation » de son brevet sur du colza RoundUp Ready après la découverte de ce type de plantes dans les champs de Schmeiser. Le colza est une plante à pollinisation croisée, ce qui laisse ouverte la contamination du champ par des plantations voisines de type RoundUp Ready. Mais l’insistance de Monsanto dans ce procès nous montre comment les transnationales vont établir des monopoles sur les ressources biologiques. Ces actions auront des conséquences dramatiques dans les pays en développement puisqu’elles dénient leurs droits sur des ressources vitales et finiront par atteindre les capacités même de survie des communautés.
Les intérêts commerciaux qui fabriquent des ressources biologiques pour de larges marchés vont mettre en danger les ressources de base, et avec elles les savoirs qui ont été développés pour les cultiver et les utiliser. L’impact sur les femmes, et au travers elles sur leurs familles, seront immédiats. On assiste déjà à une disparition de plantes médicinales rares dans les régions de collines d’Inde en raison de la collecte menée par les compagnies pharmaceutiques. Une sousespèce de Taxus baccata, le Himalaya Yew des régions himalayennes est en voie de disparition en raison de sa surexploitation, liée à ses propriétés anticancéreuses. De larges zones du Kumaon et du Garhwal, dans l’Inde hymalayenne ont été vidées de leurs plantes médicinales par des ramasseurs qui les collectent pour de grandes compagnies indiennes ou étrangères. Cette dégradation de la flore signifie que les femmes perdent les ressources qu’elles utilisent pour soigner leurs familles et leurs animaux. Les brevets sur les semences vont détruire les capacités des femmes à sélectionner des variétés nouvelles, adaptées aux conditions locales pour la médecine et les cérémonies. Ceci va empiéter sur les conditions de sécurité alimentaire des familles autant que sur les identités socioculturelles des communautés. Les femmes ont sélectionné des plantes pour des usages particuliers, qui sont partie prenante des habitudes alimentaires autant que des pratiques religieuses locales. Certaines variétés sont offertes aux Dieux lors des cérémonies. D’autres jouent un rôle rituel dans les mariages ou les cérémonies de décés.
Quand les brevets seront autorisés, il n’y aura plus moyen de distinguer la source biologique, ni les connaissances clés qui ont servi à l’invention revendiquée, c’estàdire le savoir indigène des caractéristiques de telle ou telle plante. La biopiraterie est une forme de vol des propriétés intellectuelles des communautés locales. Dans le cas des brevets sur le turmeric ou le neem, le savoir ancestral des propriétés analgésiques ou fongicides respectives de ces plantes ont servi au dépôt de brevets à l’US Patent and Trademark Office. Les conséquences sont à double verrouillage. L’application du brevet en Inde pourrait conduire à un contrôle commercial sur le traitement de la douleur ou les produits antiseptiques dérivés du turmeric ou du neem, en le retirant aux femmes. Et d’un autre côté, le potentiel industriel et commercial que l’Inde pourrait tirer d’une exportation de ces produits vers les ÉtatsUnis est rendue impossible, du fait que le brevet, déposé aux ÉtatsUnis, permet de bloquer les importations.
Que ce soit dans le domaine des plantes médicinales ou en agriculture, il apparaît clairement que les femmes seront exclues de la prise de décision. Elle auront de moins en moins leur mot à dire sur le choix des plantations, car l’accès aux semences se déportera de plus en plus vers les plantes qui ont un seul trait dominant. Les femmes auront ainsi moins de choix et moins de souplesse pour valoriser des usages multiples des plantes (alimentation humaine ou animale, médecine, cérémonies,...). Comme la participation économique pour compenser ces pertes ne sera pas possible pour les femmes, ou bien sera l’occasion de leur faire porter un fardeau supplémentaire, il est plus vraisemblable que ces dépossessions deviendront permanentes.
Réponse du Sud
L’Inde, le Brésil, la Chine, Cuba, la République dominicaine, l’Équateur, le Pakistan, la Thaïlande, le Vénézuela, la Zambie et le Zimbawe ont demandé au conseil de l’Accord sur les ADPIC d’inclure des clauses additionnelles. Cellesci devront garantir que celui qui dépose un brevet relatif à du matériel biologique ou des savoirs indigènes doit indiquer le consentement de la source et du pays d’origine de la ressource biologique ou du savoir qui est inclus dans l’invention. Le déposant devrait aussi délivrer l’assurance du consentement éclairé et d’un partage équitable et juste des bénéfices suivant les régimes nationaux concernés.
Ces pays poussent aussi à l’instauration d’un régime qui garantisse des protections aux connaissances indigènes. En raison de l’opposition des pays développés, et particulièrement des ÉtatsUnis, aucune avancée n’a pu être enregistrée sur ces propositions. Au contraire, les pays développés se font les avocats d’une approche « ADPIC + ». L’Union Européenne et les ÉtatsUnis font pression sur les pays au travers d’accords bilatéraux pour qu’ils acceptent des régimes de propriété intellectuelle encore plus excessif que ce que demande l’OMC. Et nombre de ce type d’accords qui vont plus loin que celui sur les ADPIC sont d’ores et déjà signés.
Aller de l’avant
La seule solution pour garantir un marché équitable pour les communautés des pays en développement est de retirer la biodiversité de l’Accord sur les ADPIC. Et dans l’attente de la réalisation de cet objectif ambitieux, une solution consiste à mettre en place une nouvelle suspension pour cinq ans de l’implémentation de l’Article 27.3(b) afin que les pays en développement puissent élaborer leur stratégie. Dans tous les cas, les pays en voie de développement doivent s’assurer au minimum qu’il n’y aura pas d’extension de l’Accord sur les ADPIC, comme les pays développés essaient de le faire dans les traités bilatéraux.
Les pays doivent différer l’implémentation de l’Accord sur les ADPIC dans leur propre législation tant que les décisions prises à Doha ne sont pas stabilisées, et que leur compatibilité avec l’Accord sur les ADPIC n’a pas été garantie.
Une autre approche du problème pourrait être de négocier au niveau international pour établir la prééminence de la Convention sur la Diversité biologique (CDB) sur l’Accord sur les ADPIC. L’article 22 de la CDB précise : « Les règles définies dans cette convention ne doivent pas affecter les droits et les obligations des parties prenantes qui découlent d’un autre accord international, à l’exception des situations où l’exercice de ces droits et obligations pourrait causer des dommages sérieux ou menacer la biodiversité. »
Il est clair que l’implémentation de l’Accord sur les ADPIC se fait au détriment de la biodiversité. Les États signataires de la CDB doivent oeuvrer pour que l’implémentation de l’Accord sur les ADPIC soit rendu compatible avec les conditions définies par la Convention pour la Diversité biologique.
Ce texte est extrait du livre Pouvoir Savoir : Le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle. Ce livre, coordonné par Valérie Peugeot a été publié le 1 avril 2005 par C & F Éditions. Il accompagne la rencontre "Le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle" organisée par l’Association Vecam à Paris.
Le texte est sous licence Creative Commons paternité, pas d’utilisation commerciale.
La connaissance doit être offerte en libre-accès... mais auteurs et éditeurs ont besoin d’une économie pour poursuive leur travail. Si vos moyens vous le permettent, n’hésitez pas à commander le livre en ligne (13 €)