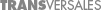Economie solidaire : une affaire de femmes
26 novembre 2006 | par Joëlle Palmieri
Transversales Sciences Culture : Qu’appelle-t-on économie solidaire et quel rôle y jouent les femmes ?
Joëlle Palmieri : Née il y a plusieurs siècles, l’économie solidaire cherche à valoriser les richesses d’une société, qu’elles soient marchandes ou non, monétarisées ou pas. Elle englobe l’ensemble des activités humaines susceptibles de créer du lien social de proximité, en s’appuyant sur une activité économique. L’économie solidaire s’inscrit dans une pensée héritée des socialistes utopiques. Celle-ci refuse d’enfermer la richesse d’une société dans la face émergée de l’iceberg que constitue l’économie de marché capitaliste telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Depuis toujours, le rôle des femmes dans l’économie solidaire a été prédominant, même s’il n’a pas toujours été pensé consciemment comme tel : le troc, le marché informel, la tontine, sont des instruments de l’économie solidaire que les femmes pratiquent depuis des siècles sous toutes les latitudes. A elles seules, les femmes portent 80 à 85% de ces activités économiques, pays du Nord et du Sud confondus.
On notera cependant que, comme dans l’économie capitaliste, ce sont des hommes qui occupent majoritairement les places de responsabilité dans les structures de l’économie solidaire. En réalité dès que l’économie solidaire sort de l’informel, s’institutionnalise, que ce soit sous forme d’association ou de coopérative, les hommes reprennent les rênes. Il y a une corrélation étroite entre visibilité et présence des hommes. La remise du prix Nobel de la paix à Mohammad Yunus, président de la Grameen bank, est parfaitement représentative de ce décalage : ce sont à 95% des femmes qui ont créé et pratiquent le micro-crédit depuis des siècles, mais c’est un homme qui reçoit le prix ! Cette masculinisation des postes à responsabilité de l’économie solidaire se fait avec la complicité inconsciente des femmes, qui semblent fuir toute forme de publicité (au sens de « rendre public »), de médiatisation, aussi confidentielle soit-elle.
TSC : Comment expliquer ce décalage entre l’investissement des femmes dans l’activité économique et leur refus de la visibilité ?
JP : On touche ici à une dimension très profonde du système patriarcal, dans lequel la sphère privée - le domus - est le domaine privilégié de la femme - alors que la sphère publique est réservé aux hommes. Tant que l’activité économique reste informelle, les femmes ont le sentiment d’évoluer dans la sphère privée et se sentent donc tacitement « légitimes ». Dans la mesure où l’économie informelle touche au lien social, il n’y a pas, à leurs yeux, de discontinuité avec leurs autres activités fondamentales de « production/reproduction » : mettre au monde, alimenter, éduquer, soigner... Elles déploient dans l’activité économique les mêmes trésors d’inventivité que pour leur activité de reproduction. Comme l’expliquent Maria Mies et Vandana Shiva dans leur ouvrage L’écoféminisme (1983 - trad. française 1999 - Ed. L’Harmattan), il y a non seulement cohérence mais consolidation entre système patriarcal et système capitaliste.
Par leurs multiples activités, rémunérées ou non, liées à l’éducation, la santé, la nutrition, l’entretien de la terre, les femmes nourrissent le socle d’une économie dont la partie capitalistique ne représente qu’une faible part. Ce décalage entre économie visible (économie dite « dominante ») et économie invisible (celle portée par les femmes) est encore plus flagrant dans les pays pauvres. En Afrique, il est quasi impossible de lancer des activités capitalistes puisque d’une part les ressources naturelles sont en voie d’épuisement et d’autre part les investissements nécessaires au lancement d’activités nouvelles sont absents (seuls 0,9% des investissements viennent de l’extérieur du continent dont 90% sont absorbés par la seule Afrique du Sud). L’économie informelle, tenue par les femmes, est donc celle qui permet à ce continent de survivre.
TSC : Cette implication des femmes dans l’économie solidaire est-elle positive et leur permet-elle de transformer leur existence ?
JP : Pour la plupart c’est tout simplement une question de vie ou de mort ! Ces femmes rivalisent d’inventivité pour survivre ! Et souvent en partant de presque rien. Prenons l’exemple de cette communauté de femmes vivant dans un bidonville de 300 000 habitants à Karachi (Pakistan). Leur objectif premier est de sortir de l’habitat de cartons, planches et débris, pour avoir un habitat en dur susceptible de résister aux intempéries. Une ONG indienne leur a offert une machine à coudre. Une seule machine à coudre ! Elles se sont organisées avec une gestion de planning digne des meilleurs cours de management, pour utiliser cette machine de façon tournante au maximum de ses capacités et coudre des chemises à partir de tissus de récupération. Avec le produit très modeste de la vente de ces chemises, elles ont commencé à construire un premier habitat en dur, puis à acheter une seconde machine et ainsi de suite. Au bout du compte, il s’agit d’une véritable reconquête du bidonville par ce groupe de femmes. L’ONG les soutenait uniquement en parallèle sur les questions de santé (dispensaire, planning familial, vaccination des enfants). Avec aussi pour résultat un passage à une maternité plus choisie et une baisse de la natalité (de 12 à 6 enfants).
TSC : Peut-on percevoir des différences d’un continent à un autre dans la manière dont ces femmes conduisent ces activités d’économie solidaire ? Existe-il des initiatives similaires dans les pays riches ?
JP : En Afrique plus que partout ailleurs, les femmes savent produire à partir de rien. Elles sont particulièrement douées pour créer les outils de l’économie solidaire, comme les caisses d’épargne et les mutuelles de santé. En Amérique Latine, elles ont un sens de l’organisation très poussé, mais à l’inverse ne savent pas créer les outils. Dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, où les problèmes de survie ce posent avec un acuité renouvelée liée à l’intégration dans l’Union européenne, ces femmes savent très bien mener un travail de lobbying pour faire reconnaître leurs droits et obtenir des subventions nécessaires à leurs projets. Mais il existe des groupes de femmes très actives aussi dans les pays dits développés, notamment au Québec mais aussi en France. Ainsi à Dinan en Bretagne, des femmes artisanes (créatrices d’accessoires de mode, relieuses de livres, vendeuses de pizzas, etc.) ont monté un réseau pour essayer d’améliorer leur situation souvent très difficile. Elles entendent travailler autour de la logique de mutualisation et de coopération, en partageant par exemple un cabinet comptable pour faire des économies d’échelle, ou un stand sur un salon...
TSC : Par le biais de cette implication, peut-on considérer que les femmes sont des vecteurs de changements dans les sociétés dans lesquelles elles se sont investies ?
JP : Tout à fait. Prenez l’exemple de cet autre bidonville d’un million d’habitants, cette fois-ci situé à Porto Alegre, au Sud du Brésil. Bidonville où règnent violence domestique, trafic de drogue et d’armes, prostitution... Un groupe de 300 femmes s’est organisé pour résister à cette violence. La mairie leur a attribué un bâtiment de 1000 m2 à l’abandon, dans lequel elles ont initié une activité de recyclage de déchets. Tous les jours, les camions poubelles de la ville viennent y déverser leur collecte et ces femmes trient le plastique, le verre ou le carton, qu’elles revendent ensuite à des entreprises privées qui les utilisent comme source d’énergie. Au bout de quelques années d’activité, le changement est profond, grâce à une réaction en chaîne. Outre le fait de générer un revenu, elles se sentent valorisées personnellement et changent ainsi le regard que leur famille, mari et enfants, portent sur elles. Cette transformation a modifié les rapports sociaux au sein du bidonville. S’en est suivi une baisse non seulement de la prostitution, mais du niveau général de violence. C’est toute la vie du bidonville qui a changé.
Autre exemple plus près de nous, dans le quartier de La Saussaie à Saint Denis (93), quatre femmes ont créé une radio « Declic ». Puis, de là, elles ont initié des formations aux techniques sonores et rédactionnelles, au reportage. Puis elles ont monté des ateliers de chant auxquels les rappeurs se sont associés et pour finir un studio d’enregistrement ! Peu à peu, ce sont les enfants, les amis, les voisins, qui sont venus, qui faire un reportage sur la cité, qui participer à un atelier de musique.
D’une manière générale, l’activité de ces femmes impacte le développement local. En France on constate que dans les quartiers dits « difficiles » où ces femmes sont actives, que ce soit dans des associations d’alphabétisation, de suivi scolaire, de broderie, de pose d’ongles, de chant, de cuisine... la criminalité diminue, les voitures arrêtent de brûler !
TSC : Quelles sont les limites auxquelles se heurte l’économie solidaire portée par ces femmes ?
Elles manquent par-dessus tout de visibilité et donc de reconnaissance, aussi bien localement que globalement. Nous nous battons pour que ces femmes valorisent ces richesses non monétaires dont elles sont porteuses, y compris en les inscrivant dans leur bilan comptable. Enfin il est essentiel que cette dimension collective et coopérative, qui s’inscrit au cur de l’économie solidaire, diffuse dans la politique !
Pour en savoir plus, quelques sites d’initiatives de femmes en économie solidaire :
 Marseille : Femmes d’ici et d’ailleurs
Marseille : Femmes d’ici et d’ailleurs
http://www.femmes-dici-et-dailleurs.org
http://www.penelopes.org/xarticle.php3 ?id_article=2211
http://mediterranee.france3.fr/emissions/mediterraneo/emissions/2005/7567646-fr.php
 Saint Denis : Radio Declic
Saint Denis : Radio Declic
 Serbie : Zene na delu ("femmes au travail")
Serbie : Zene na delu ("femmes au travail")